LA TÊTE EN FLEURS
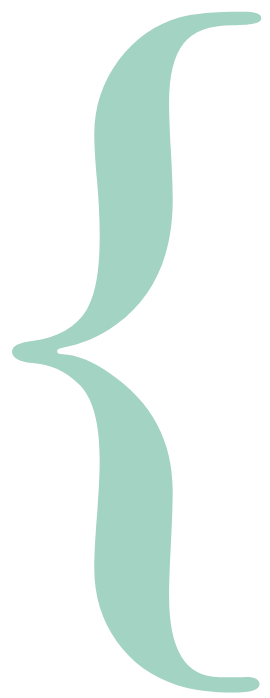
L’histoire de l’œuvre
Avec La Tête en fleurs, les héros de Christine de Rivoyre quittent les rues et les quartiers de Paris pour traverser l’Atlantique et se balader aux Etats-Unis entre Syracuse et New York. La romancière s’inspire ici de ses années d’études à l’école de journalisme de 1947 à 1949 à l’Université de Syracuse, pour lesquelles elle avait obtenu une bourse, et de ses amis de l’époque, notamment Joan Phelan Tuttle avec qui elle nouera une amitié durable (voir également Le Voyage à l’envers et Flying-Fox). Ce n’est pas la première fois que Christine de Rivoyre évoque son expérience américaine. Outre quelques mentions dans ses interviews d’artistes américains pour Le Monde, elle en avait fait la matière de plusieurs longs articles de presse publiés dans les revues Caliban et Rapports France-Amérique, au début des années 50. Mais c’est la première fois qu’elle y revient sous la forme d’une fiction romanesque, comme elle le fera ensuite dans La Glace à l’ananas et, plus tard, dans Le Voyage à l’envers.
Au fil du texte
Charlotte, brillante élève originaire de Poitiers, obtient une bourse pour l’université de Syracuse. Elle loge à son arrivée dans la maison d’un couple, Kay et son futur mari, le musculeux Œdipe Washington, deux noirs en but au racisme et à l’intolérance dans l’Amérique de l’après-guerre. Très rapidement, Charlotte fait la connaissance d’Elizabeth, Liz, une belle blonde, brutale et dynamique, qui décide de présenter sa nouvelle amie à son père, le baron de Follin, surnommé « Tyran de Syracuse », un célèbre peintre abstrait natif du Périgord. Arrivée dans la demeure familiale, aussi étrange que ses occupants, l’héroïne tombe sous le charme de Tyran et accepte de tout abandonner pour devenir la nouvelle maîtresse des lieux jusqu’à se réveiller de ce qui n’était peut-être qu’un mauvais rêve.
Réception
« Pour découvrir l’Amérique, la vraie, il vous suffit de vous installer confortablement, de prendre La Tête en fleurs, de l’ouvrir et de suivre Charlotte, native de Poitiers, dans son rêve-voyage… » Ainsi débute l’argumentaire des éditions Plon à destination de la presse et des lecteurs. Gageons qu’ils ont dû être surpris par cette présentation qui faisait d’un roman une sorte de guide touristique et à tout le moins un document sur l’Amérique des années 50. Bien sûr, l’évocation sans complaisance de l’intolérance et du racisme qui régnaient alors aussi bien dans les « sororités » que dans le quartier de Harlem à New York relève d’une telle lecture, mais elle ne constitue pas l’essentiel du roman qui poursuit d’un certain point de vue l’évocation d’une famille d’originaux, comme dans La Mandarine, tout en accentuant, plus encore que dans les deux premiers romans, la part autobiographique du personnage principal. Cela n’échappa pas à Robert Escarpit qui donna dans Le Monde une critique mitigée du roman : « Le livre de Christine ne doit rien à l’Amérique, si ce n’est quelques parfums, quelques accents, quelques gestes. Ce qu’on découvre dans ce livre c’est elle-même et, je suppose, la vraie Christine », tout en saluant « la fraîcheur et la netteté du style ». La Tête en fleurs est un roman atypique dans l’œuvre qui semble flotter entre le rêve – dans l’évocation hallucinée et quasi surréaliste de la famille réunie autour de Tyran, génial quadragénaire séducteur – et une observation nostalgique et sans concession d’une jeunesse étudiante dans l’Amérique de Truman et de McCarthy. Malgré des réticences sur les personnages peu attachants du roman, la presse saluera quelques morceaux de bravoure comme l’exposition des tableaux abstraits, « triomphe du snobisme », ou la scène de séduction entre Œdipe Washington et Liz.
Anectdote
La Tête en fleurs est le seul roman de Christine de Rivoyre à ne pas avoir l’objet d’une réédition en collection de poche.
Extrait
« Cette nuit-là, à Skeneatles pas plus qu’à Syracuse, on ne voyait rien. C’était le 22 février, jour anniversaire de la mort – ou peut-être de la naissance – de George Washington ; comme chacun sait, ne serait-ce que pour la décoration de leurs statues, les grands hommes ont un faible pour la neige. L’Eternel, sage boy-scout, ne leur refuse guère ce privilège quand revient leur nom sur le calendrier de l’Histoire. Donc il neigeait à gros bouillons, il y a quelques années, un 22 février, entre Syracuse et le lac Skeneatles. Cela faisait vingt kilomètres, sinon plus, de paysage fou, de maisons hachées à la sauce pointilliste, de batailles de confettis blancs, mous, mouillés. Ballotées entre les murettes édifiées par le chasse-neige, les voitures, semblait-il, ne devaient circuler qu’au pas de l’homme. Pourquoi alors cette Plymouth décapotable – heureusement recapotée – filait-elle si vite sur ce chemin lunaire ? »

OEUVRES
- L’Alouette au miroir (1955)
- La Mandarine (1957)
- La Tête en fleur (1960)
- La Glace à l’ananas (1962)
- Les Sultans (1964)
- Le Petit matin (1968)
- Le Seigneur des chevaux (1969)
- Fleur d’agonie (1970)
- Boy (1973)
- Le Voyage à l’envers (1977)
- Belle Alliance (1982)
- Reine-mère (1985)
- Crépuscule taille unique (1989)
- Racontez-moi les flamboyants (1995)
- Archaka (2007)
- Flying Fox et autres portraits (2014)