CITATIONS
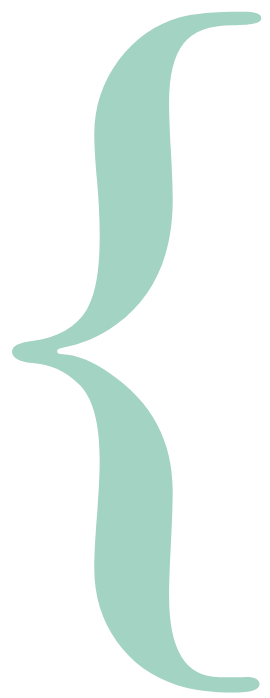
Amour
« L’amour me donne faim. Est-ce un crime ? Georges pense que oui, je le sais, je le sens. Dans un instant, je vais détacher ma jambe de la sienne, mon cou de son bras et je roulerai à plat ventre en disant : Que j’ai faim ! » (La Mandarine, 1957)
« L’amour ça ne se juge pas, le bonheur ça ne se refuse jamais et le plaisir ça se prend. » (Ch. de Rivoyre, Fleur d’agonie, 1970)
« Le goût, c’est le désir sans la peur. » (La Mandarine)
« J’aime les situations nettes, moi, les grandes lessives, les coupures franches. Un couple ce n’est pas une chose bancale, un joug que l’on s’impose, ce n’est ni l’aveuglement ni le malaise ni l’héroïsme de l’un face à la désertion de l’autre, tout ce dévouement, comme dit Manuel, en échange de quoi ? De rien. » (Belle-Alliance)
Chevaux
« Les chevaux c’est la joie, avec eux on devient quelqu’un d’autre, tout ce qu’on connaissait avant, ça devient petit et, tiens, même, ça devient pauvre. » (Ch. de Rivoyre, Le Petit matin, 1968)
« Je n’ai jamais cru en Dieu qu’à cheval » (Christine de Rivoyre)
« Souvenirs de hardiesse, d’envol, de jubilante domination. Petit trot, grand trot, petit galop, canter du Tounedou au Baqué, de Perrac à Branelongue, de Tuyenet à Lestajaou, de Bordessoule à Plinguet et le sang s’échauffe dans le matin exquisément frisquet, le corps se métamorphose, les reins poussent des racines dans le dos du cheval, les cuisses s’allongent. La piste de sable n’a aucune raison de prendre fin, la pourpre marée de bruyère s’avance et se retire au rythme des sabots. » (Belle-Alliance)
Corps
« Chaque jour, depuis que je suis en vacances, je m’exerce à la mort de mon âme, je lui dis va-t’en, quitte ton enveloppe charnelle, je me couche à plat ventre sur le sable d’Hendaye-Plage et je recense les morceaux de mon corps, des pieds à la tête, j’écoute leurs vies individuelles, les jardins de sang, la chambre des nerfs, de muscles. Puis je vais me baigner dans les vagues, je nage, je fais la planche, je plonge, j’adore plonger, dix, vingt fois de suite, de plus en plus vite, je perds le souffle, ça m’exalte, je deviens solennelle : Mon Dieu, je remets mon âme entre Vos mains. Je vois les mains de Dieu descendre dans la mer, deux mains, sans bras, scintillantes, comme en diamant. Elles s’emparent de mon âme qui fond comme une poignée de neige, je ne suis plus qu’un corps lancé dans l’eau, brun, caressé et long. Si long. » (Boy, 1973)
« J’ai toujours cru à l’importance du corps. A corps heureux, âme belle, âme comblée. Le délice que procure une peau, même si on ne fait que l’effleurer, vient de l’esprit qui souffle dessous, dedans, qui la hante et la divinise. » (Belle-Alliance)
Femmes
« Ah, tous ces ne, ces pas, ces plus, cette succession de négations, de dérobades, d’absences, la vie en forme de vide. Mais le vide n’a pas de forme, il n’est qu’une couleur, blême, fatale, comme la cendre, je suis une femme de cendre. » (Margot dans Belle Alliance, 1982)
« J’ai toujours tenu à mon indépendance, je l’ai toujours chèrement acquise. Pour cela, à vingt ans, j’étais en avance sur mon époque. Mais je n’aime ni les défilés, ni les étendards. »
Les Landes
« Tout m’ensorcelle sous les pins, au long des chemins de sable d’un blanc d’ossements. Brisées, détrempées, les fougères sont d’un brun chaud d’écaille ou de chocolat. Les légendes landaises regorgent de loups garous, de fées facétieuses, de génies à la fois redoutables et très gais. Qui sait si certains d’entre eux ne rôdent pas près de moi, derrière les hauts bouquets d’herbes sèches, les « aougues », et plus loin, au fond du pré où j’enfonce jusqu’à mi-mollet, au bord du ruisseau qui va son train paisible entre les chênes tauzins et les vergnes dont le bois sert au sabotier Elie Lestruhaut pour faire nos sabots ? J’ai peur et je n’ai pas peur. Je veux cueillir l’instant dans tout son charme vif, immédiat, ne rien en perdre. J’ouvre grand les yeux, je tends l’oreille à tous les bruits, à tous les chants, aux moindres musiques d’Onesse et toutes les odeurs montent à mon nez… » (Christine de Rivoyre)
« Ce pays, je l’aime farouchement. Ma susceptibilité en ce qui le concerne ne connaît pas de frein. Je permets, à qui en éprouve l’envie, de se moquer de mon nez (il est sans doute trop long), de critiquer mes livres (ils sont peut-être trop courts). Mais gare à celui qui accuse ma forêt d’être monotone, son sous-bois triste, ses rivages impraticables. » (Christine de Rivoyre)
« Les Landes, c’est l’anti-Côte d’Azur. » (Christine de Rivoyre, Figaro, 8 août 1973)
« Les Landes, c’est mon pays, c’est mon coeur géographique. Mon pays, en réalité, fait partie d’une région dont il est néanmoins totalement dissemblable. Les Landes sont doubles. D’un côté la Chalosse, grasse, verte et opulente. De l’autre, le Marensin, océanique et sylvestre, autant dire âpre, sauvage et violent. A mes yeux, le Marensin (c’est ma région) incarne les vertus du grand romantisme. Je ne peux pas m’empêcher de penser aux livres des soeurs Brontë, en particulier les « Hauts de Hurlevent », lorsque je séjourne dans mon pays. J’évoque également le souvenir de Victor Hugo. C’est, je crois, l’aspect rituel, quasi religieux, en même temps que féroce de mon pays qui me bouleverse. La forêt est pour moi comme une cathédrale primitive. Quant à l’océan tout proche, il m’apparaît comme le miroir des passions et même de l’âme. Je considère comme un privilège d’être landaise. » (Christine de Rivoyre)
« Les Landes, je les découvrais tous les ans, à Noël et au Nouvel An. Notre famille se retrouvait à Onesse. J’ai huit ans, dix ans, davantage. Je suis de nouveau dans la cuisine de la maison aux volets gris. On ne m’emploie pas, je suis trop maladroite, je ne sais que regarder, je regarde la comédie gastronomique, j’enregistre opérations, répliques, fumets et puis soudain je m’enfuis. Voici le jardin, un vif soleil d’hiver fracasse en douceur les brumes attardées, les chères brumes landaises. Les tilleuls et les érables sont nus, les magnolias privés des lourdes fleurs blanches dont, l’été venu, m’enchantera le parfum de poivre et de citron mêlés. L’araucaria ressemble à un gigantesque serpent aux écailles en relief, il y a aussi un pin franc très très grand, très très vieux (peut-être a-t il été planté par le père du trisaïeul de ma grand-mère qui était juge) et une haite de bambous, deux tonnelles, quatre ou cinq palmiers que l’on abattra bêtement, férocement, comme l’on a abattu la maison (le jour où j’ai possédé un jardin, mon premier soin a été d’y planter des palmiers). A gauche, la petite usine de produits résineux qui ne fonctionne plus et dans les cuves et les toboggans de laquelle nous aimons bien jouer. A droite, à deux pas, la forêt. C’est elle que je choisis, vers elle que je cours. Seule, en sauvage née et bien exercée, sans prévenir qui que ce soit. Tout m’ensorcèle sous les pins, au long des chemins de sable d’un blanc d’ossement. Brisées, détrempées, les fougères sont d’un brun d’écaille ou de chocolat. Les légendes regorgent de loups garous, de fées facétieuses, de génies à la fois redoutables et très gais. Qui sait si certains d’entre eux ne rodent pas près de moi, derrière les haut bouquets d’herbes sèches, les aouges, et plus loin au fond du pré où j’enfonce jusqu’à mi-mollets, au bord du ruisseau qui va son train entre les chênes tauzins et les vergnes dont le bois sert au sabotier Elie Lestruhaut pour faire nos sabots ? J’ai peur et je n’ai pas peur. Je veux cueillir l’instant dans tout son charme vif, immédiat, ne rien en perdre, c’est trop excitant. J’ouvre grands les yeux, je tends l’oreille à tous les bruits, à tous les chants, aux moindres musiques d’Onesse et toutes les odeurs montent à mon nez – qui est déjà long. Je plonge mes mains dans la terre humide et l’eau glacée avec autant de volupté que ma grand’mère plonge les siennes dans les terrines de Noël. » (Ch. de Rivoyre, Flying-Fox et autres portraits, éd. Grasset, 2014)
« La forêt des Landes est un monde. Pour peu que l’on s’y aventure au moment propice, que l’on fasse durer l’exploration de façon convenable, butes, collines, vals, vallées, sentiers riches en tournants et en surprises, allées si longues qu’elles vous semblent rejoindre le ciel, fossés, ravins de toutes tailles, obstacles inattendus, les cadeaux qu’y offre une nature comparable à nulle autre sont d’une extrême variété (…). C’est la forêt magique du Petit Poucet, c’est la jungle amicale où les chevreuils ont remplacé les loups, une brousse peuplée de sources et de ruisseaux qui chantent, c’est le paradis rude et singulier que je me suis choisi et tant pis si c’est trop tard pour lui en préférer un autre. » (Crépuscule taille unique, 1989)
« Les Landes, ce sont les racines que je me suis offertes. » (Propos recueillis par Patrick Berthomeau, 1977)
Mère
« Parce que c’est elle que je suis venue chercher en venant ici, elle que j’entends quand j’écoute, la nuit, le rossignol et la hulotte et le jour, les merles et la huppe dont elle imitait si bien le cri. Veux-tu croire Margot. Si tu savais Margot. As-tu lu ceci ? As-tu entendu parler de ça ? Je veux être seule pour mieux revivre sa vigilance savoureuse, ressusciter ses questions, sa jolie science glanée au fil des livres et de la vie. » (Belle Alliance, 1982)
Nature
« Il y a des gens comme ça qui ne reconnaissent pas la haine, pourquoi la reconnaîtraient-ils ? Ils ne l’ont pas connue, ils sont nés tranquilles et distraits, ils aiment la nature pour la contempler, pas pour la vaincre. » (Le Petit matin, 1968)
Pays natal
« Elle eut recours au remède que l’enfant de la campagne réclamait de tout son corps, de tous ses sens, elle se laissa couler dans la terre de son pays, dans l’odeur verte, un peu âcre de l’herbe et se sentir devenir herbe, feuille, mousse, terre, jardin. Alors les larmes jusque-là retenues, coulèrent, envahirent ses joues, glissèrent jusqu’à sa bouche. » (Belle Alliance, 1982)
« Nous reviendrons. Souvent. A Belle Alliance et au Bidaou. Avec lui ou sans lui. A l’automne et en hiver, au printemps. Quand la calune allumera un grand feu mauve et doux sous les pins. Quand les fougères détrempées par de longues averses formeront une immense vague couleur d’écaille. Quand le ruisseau au pont de leus Crabes sera près de déborder et son eau presque rouge à cause de l’alios. Nous reviendrons sur la dune et dans la lette et sur la plage. » (Belle Alliance, 1982)
« A droite, à deux pas, la forêt. C’est elle que je choisis, vers elle que je cours. Seule, en sauvage née et bien exercée, sans prévenir qui que ce soit. Tout m’ensorcèle sous les pins, au long des chemins de sable d’un blanc d’ossement. Brisées, détrempées, les fougères sont d’un brun d’écaille ou de chocolat. Je veux cueillir l’instant dans tout son charme vif, immédiat, ne rien en perdre. J’ouvre grands les yeux, je tends l’oreille à tous les bruits, à tous les chants, aux moindres musiques d’Onesse et toutes les odeurs montent à mon nez – qui est déjà long. Je plonge mes mains dans la terre humide et l’eau glacée avec autant de volupté que ma grand’mère plonge les siennes dans les terrines de Noël. » (Christine de Rivoyre)
« Dans le village de ma grand-mère, devenu celui de ma mère et récemment le mien, on les trouvait chez Elie Lestruhaut, le sabotier, ces cartes postales aux jolis dégradés sépia et terre de Sienne. Je revois la petite fille que j’étais grimper les cinq marches qui conduisaient au magasin Lestruhaut. Face à la porte d’entrée, l’épicerie-mercerie, le comptoir qui embaume la cire de bruyère et le clou de girofle, le bocal où sont prisonnières les souris en chocolat (leurs queues sont en réglisse), celui des acidulés minuscules et multicolores appelés juliennes. Près de la fenêtre, la vitrine. Là-dedans, enfin, et soigneusement rangées, enveloppées de papier de soie, presque dissimulées parmi les rubans fantaisie, les barrettes Kirby et les épingles neige, les fameuses cartes postales.
J’arrête le temps, c’est l’été. Les volets gris sont à l’espagnolette, le carillon de la porte fait entendre ses deux notes, chaque fois qu’une ménagère vient acheter du fil, de la moutarde, des pelotes de laine, des haricots ou des sabots. J’enregistre les voix, le dialecte gascon si évocateur que je finis par comprendre un mot sur deux, on parle de la sécheresse si dure au maïs, de l’orage terrible qui a foudroyé une mule dans une métairie, de la mort d’un voisin, de la fête prochaine. J’écoute la chronique de mon village et je regarde les cartes postales. Les beaux jours engloutis, l’hiver revenu avec son morose cortège de problèmes d’algèbre et de confessions hebdomadaires, mêlées à mes souvenirs de vacances, des images seront là, intactes dans ma tête et lumineuses, consolantes. Elles me parleront du pays qui, depuis mon plus jeune âge, m’ensorcelle, celui que, sans l’ombre d’une hésitation, je choisirai pour y vivre le second versant de ma vie. » (Christine de Rivoyre, Les Landes 1900-1930)
« Mon image favorite est celle du cassecan. C’est ce personnage singulier qui a une guirlande de fleurs sur le seuil de sa porte, il est le messager chargé d’inviter les habitants d’un quartier à un mariage, il sera l’échanson durant les deux jours que durera la fête, il encouragera le joueur de cornemuse, le joueur de flûte et les danseurs de rondeau ou de scottish qui sauteront sur l’airain jusqu’à la tombée de la nuit, plus tard, jusqu’à l’aube, dans les brumes qui monteront du ruisseau tout proche, ces brumes, encore un sortilège de mon pays où, si on se donne la peine de bien l’observer, tout est poésie. » (Christine de Rivoyre)
Le temps
« Je ne vois pas de sens à la vie. Et le but ne m’intéresse guère. Je constate que je suis en vie, c’est tout… Et je constate, pour l’avoir éprouvé et l’éprouver encore, que le plaisir existe – même s’il est souvent entaché de souffrance. En dépit de l’éducation que j’ai reçue et des beaux exemples de vie qui m’ont été donnés par mes parents, j’ai réduit en miettes leur système. Je n’ai pas le sens de l’éternité ni le désir qu’elle existe. Je bute sur l’univers qui m’entoure, les êtres que je croise, ceux auxquels je m’attache, je ressens sans précautions les émotions qu’ils me procurent comme ceux que m’offrent la nature, les livres, la musique, les chiens, les chevaux, le silence, et j’assiste à leur effritement. J’assiste à la fuite du temps et mon seul refuge, c’est la mémoire. » (Christine de Rivoyre)
« Les occasions perdues sont les seuls péchés que je connaisse. » (Christine de Rivoyre, 1974)
Vie littéraire
« Les gangs passent, les livres restent. » (Michel Déon à Christine de Rivoyre)
« Etre un écrivaine – pas seulement un romancier qui raconte une histoire mais un écrivain qui se raconte à partir d’une histoire -, cela implique un face à face avec soi-même et donc une certaine dose de courage et peut-être d’inconscience. » (Ch. de Rivoyre)

